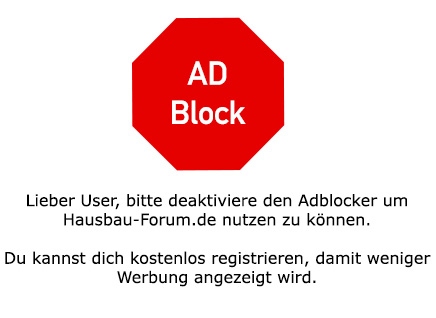chand1986
23.11.2023 06:26:45
- #1
Il n’y a pas de frein aux investissements. Il y a un frein à la politique sociale et aux subventions distribuées à tout-va. Il est absolument juste que l’État doive prioriser quelles dépenses peuvent être effectuées. La priorisation et la médiation des souhaits divergents sont la tâche première des politiciens démocratiques. L’État allemand n’a pas un problème de recettes, mais un énorme problème de dépenses. Un problème de dépenses ne se résout pas par plus d’argent, ni pour un particulier, ni au niveau de l’État. Ce n’est pas la règle d’or qui fait défaut, mais son contournement massivement abusif. Celui qui justifie une exception par une situation d’urgence devrait utiliser cette exception uniquement pour cette urgence et non pour autre chose. Et de manière sensée, on comptabilise les dépenses au moment où elles surviennent et pas à un moment quelconque dans le passé, idéalement sous le gouvernement précédent...
À première vue, ce que tu écris semble parfaitement logique et raisonnable. Néanmoins, je dois fondamentalement contredire – ce qui, bien sûr, réclame une bonne justification. Voici donc ma justification :
a) Les dépenses de quelqu’un sont les recettes de quelqu’un d’autre.
b) L’économie ne croît que si la somme des recettes d’une période définie augmente continuellement.
c) D’un point de vue macroéconomique du point de vue d’un pays(!), il y a quatre secteurs qui perçoivent des revenus et effectuent des dépenses : les entreprises, les particuliers, l’État propre, l’étranger.
Si l’on pose a) à c) comme prémisses, il s’ensuit logiquement et nécessairement ce qui suit : si au moins un des quatre secteurs reçoit plus qu’il ne dépense, l’économie s’effondre à moins qu’un autre secteur ne dépense plus qu’il ne reçoit. Donc, économiser à un endroit exige des dettes ailleurs pour que l’économie fonctionne ou même croisse.
En Allemagne, le secteur privé fait toujours des économies et depuis quelques décennies aussi le secteur des entreprises. L’endettement de l’État allemand a également été inférieur depuis des décennies à l’épargne des deux secteurs susmentionnés. Par conséquent, l’Allemagne vit depuis des décennies de dettes contractées par l’étranger. Cela se voit très concrètement dans le chiffre de l’excédent annuel de la balance des paiements.
Cette relation de dépendance peut être rompue : soit on connaît une stratégie pour faire redevenir le secteur des entreprises débiteur (je n’en connais pas et ne connais personne qui en connaisse), soit l’État allemand contracte lui-même des dettes. Ainsi, la règle d’or n’est rien d’autre que la consolidation de la dépendance vis-à-vis des dettes étrangères.
Lorsqu’un État n’utilise pas directement de l’argent pour des investissements, mais par exemple pour le social, cet argent revient aussi aux entreprises, puisque le taux d’épargne des bénéficiaires de prestations sociales est très proche de zéro. C’est donc indirectement aussi une dépense pour l’économie, qui en retour trouve un meilleur environnement d’investissement qu’elle n’en aurait sans cette dépense publique.
Par conséquent, on peut aussi toujours qualifier la règle d’or de frein aux investissements. On pourrait aussi dire frein aux recettes.
Il s’agit pour moi d’un recadrage : cela sonne immédiatement bien de freiner les dettes. Mais cela signifie macroéconomiquement aussi freiner les recettes.
Un État n’est pas comparable à une entreprise ou à un particulier : c’est un secteur complet autonome, qui, de surcroît, dispose d’une monnaie propre dans laquelle il ne peut jamais faire faillite et qui a pour mission de veiller à l’ensemble de l’économie.
Je suis d’ailleurs ouvert à la contradiction et à la critique, mais celles-ci doivent s’aligner sur la chaîne logique susmentionnée. Les phrases du genre « Mais on ne peut pas quand même… » je ne peux plus les entendre. Nous pouvons tout faire, mais ensuite nous devons aussi assumer les conséquences.