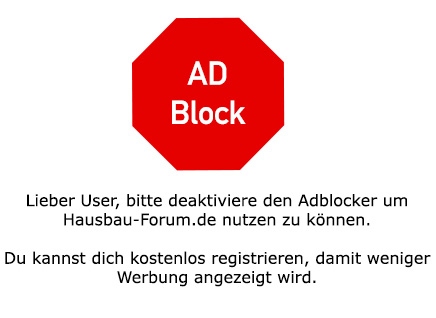Comme je connais par expérience propre à la fois les coûts de construction, de raccordement et d’extension des réseaux de chaleur de proximité (source : moi)
Le mètre de conduite de réseau de chaleur doit se situer entre 3000 et 6000 euros en cas de nouvelle construction.
Le mètre de tuyau posé dans la tranchée coûte entre 100 euros (DN 50) et 300 € (DN 250). S’y ajoutent les travaux de terrassement pour la tranchée, du même ordre de grandeur, les coûts de planification et, en milieu urbain, le poste le plus important : la réfection de la surface.
Les coûts totaux réels s’élèvent entre 200 et 300 € pour les branchements de maisons passant par des jardins, en fonction du fait qu’il faille creuser ou pouvoir forer.
Les conduites principales DN200-400 coûtent généralement autour de 1000-1500 € / mètre sur les trottoirs ou la chaussée. Il est judicieux de planifier simultanément la fibre optique / l’électricité ou autre afin de bénéficier de synergies (la surface est coûteuse).
Pour le branchement de maison, en plus des mètres de conduite, il faut naturellement ajouter l’entrée de bâtiment (500 €) et le raccordement côté réseau (également 500 €) ainsi qu’une station de transfert de chaleur (maison individuelle 5000-7000 € installation incluse).
Au total, le raccordement, lorsque la conduite est dans la rue devant la porte, tourne aux alentours de 10 000 €. Si le réseau répond aux exigences, des subventions de la BAFA sont disponibles.
3 % chauffent au réseau de chaleur, 80 % au gaz et le reste au fioul ou pompes à chaleur.
Cela devrait correspondre pour beaucoup de petites et moyennes communes. Dans les grandes villes, c’est très variable. Kiel, Hambourg et Francfort disposent de grands réseaux de chaleur, d’autres grandes villes presque pas.
Il faudrait d’une part entièrement renouveler le réseau électrique de la ville à cause des pompes à chaleur. Développer le réseau de chaleur et construire des unités de chaleur de proximité. Réaménager complètement le réseau de gaz.
Exact. Pour la transition énergétique chauffage, il faut soit généraliser le réseau de chaleur, soit renforcer le réseau électrique. En zones périurbaines et en maisons individuelles, un réseau de chaleur ne sera ni économiquement construisible ni exploitable. Le réseau électrique devra donc être adapté aux pompes à chaleur. Beaucoup de communes effectuent leur planification de la chaleur en même temps qu’une planification du réseau électrique.
Le défi consiste aussi à rendre les réseaux de chaleur verts / renouvelables. Presque tous les grands réseaux sont alimentés à près de 100 % au charbon ou au gaz naturel. Par exemple, passer le réseau de chaleur de Hambourg au renouvelable est le vrai point crucial.
Il ne semble pas que les responsables communaux soient très à l’aise, on le dit.
Ils savent cependant aussi que c’est inabordable et irréalisable.
La plupart des responsables communaux, lorsqu’ils voient pour la première fois les coûts à engager jusqu’en 2040/45, vont forcément avoir un choc. L’effort nécessaire dépend beaucoup du bâti existant et variera nettement, mais en bref : les modèles de financement classiques avec la quote-part de capitaux propres imposée aux exploitants de réseau et entreprises communales ne suffiront pas.
Pour le réseau de chaleur, on est totalement à la merci du fournisseur qui en profite pleinement selon moi. Inabordable.
Le fournisseur propose généralement une offre sur 10 ans à un prix fixe avec clause d’indexation. Cette clause prend en compte en général l’évolution des prix des combustibles utilisés et des indices de coûts unitaires et salariaux. Les coûts du fournisseur évolueront presque sûrement conformément à ces indices. S’y ajoutent (de plus en plus importantes) incertitudes concernant les exigences relatives à l’approvisionnement en chaleur. Qu’est-ce que le fournisseur peut encore exploiter où et dans quelle mesure, et quelle part d’énergies renouvelables faudra-t-il lors d’une rénovation dans 5 ans ? Les obligations de reporting pour les fournisseurs deviennent de plus en plus contraignantes et les clauses d’indexation fantaisistes sont interdites depuis longtemps. En général, une clause d’indexation juridiquement sûre sans possibilité de recours du client est de plus en plus un coup de chance. Même les cabinets d’avocats coûteux ne veulent plus garantir la sécurité juridique. Cela oblige forcément à des provisions pour mises à niveau, etc., de sorte que le réseau de chaleur ne peut pas être donné gratuitement.
Le réseau de chaleur n’est pas toujours moins cher que l’approvisionnement individuel et ce n’est certainement pas une panacée. Dans les zones densément peuplées (immeuble collectif, commerce) il peut néanmoins être plus simple et moins cher à réaliser que l’approvisionnement individuel — cela ressortira aussi des nombreuses planifications thermiques communales.
Ces dernières sont d’ailleurs beaucoup de « engineering by powerpoint » par des docteurs et professeurs. Avec un peu d’expérience et une connaissance du bâti local, on pourrait faire 90 % des affirmations aussi, simplement sans création fastidieuse de scénarios et bavardage sur l’évolution des prix dans une boule de cristal.
Car pour le réseau de chaleur aussi, il existe une obligation de raccordement et d’utilisation.
L’obligation de raccordement et d’usage est presque plus jamais imposée par les communes. Les possibilités de recours sont très larges. En général, pour les constructions neuves, la répartition du coût d’installation est intégrée dans le prix du terrain. Dans le bâti existant, un sondage est généralement réalisé en amont et ce n’est qu’après signature d’un contrat par un nombre suffisant d’utilisateurs par branche que le réseau est étendu. Ou les exploitants prennent le risque en pariant qu’un besoin approprié sera présent dans 1 à 5 ans.