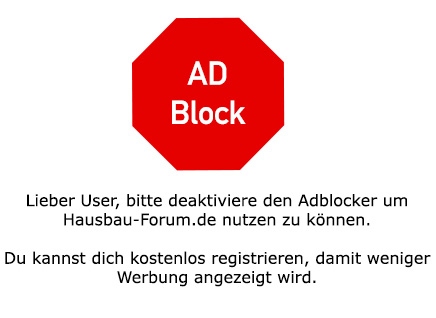Akillo!
24.07.2024 15:31:17
- #1
Parce que ce sujet sera certainement encore recherché sur Google par de nombreux maîtres d’ouvrage : les pertes de chaleur par transmission d’un bâtiment résultent de : conduction thermique, convection et pertes par rayonnement.
Une caméra thermique ne peut justifier utilement une réduction de la charge thermique d’un bâtiment que si le type d’isolation réduit linéairement les trois facteurs de perte à leurs parts respectives dans la perte totale.
Avec XPS/EPS/laine à clapet/laine de verre/chanvre/paille/copeaux de bois, c’est plus ou moins le cas. Si l’on mesure après isolation la nouvelle valeur d’émission infrarouge, sa réduction correspond à la réduction globale attendue de la charge thermique.
L’aérospatiale (d’où provient la nanopeinture) est confrontée depuis l’invention du satellite à la tâche de maîtriser les contraintes thermiques très différenciées des engins spatiaux. Avec une nanopeinture, c’est-à-dire une peinture pure, il est facile de rééquilibrer les conditions thermiques des faces exposées ou non au soleil, par exemple de l’ISS. Le point crucial est cependant que dans l’espace il n’y a ni convection ni conduction thermique, car il y a le vide. On peut ainsi, pour ainsi dire, faire en sorte qu’à l’intérieur de l’ISS personne ne se brûle la main sur la face exposée au soleil, ni que quelqu’un qui appuie son postérieur contre la face non exposée au soleil ne gèle celle-ci. Mais pourquoi les matériaux céramiques résistants aux hautes températures protègent-ils la capsule spatiale lors de la rentrée atmosphérique ? Réponse : pas parce que la NASA ou Elon Musk seraient idiots, mais parce que la nanopeinture ne repousse que la chaleur par rayonnement, et non la convection ou la conduction thermique.
Les nanopeintures réduisent donc la part du rayonnement dans les pertes de chaleur par transmission. Et plutôt bien. Il n’existe pas de valeur précise de la part infrarouge dans la maçonnerie/le bois/le plastique/les tôles sur internet. La part de convection dépend probablement fortement de l’effet du vent. La part de conduction thermique dépend de l’humidité de l’air extérieur. Selon les conditions climatiques, la part varie donc. Et justement quand la charge thermique augmente pour des raisons météorologiques (effet du vent/pluie forte), la part infrarouge diminue. Il s’agit de rayonnement IFR long, tandis que les gains par rayonnement solaire sont constitués de rayonnement IFR court.
La réduction du rayonnement IFR long par une nanopeinture devrait représenter une faible part à un chiffre en pourcentage des pertes de chaleur par transmission et, même avec un « rendement » quasi de 100 % — exprimé par une pseudo-valeur lambda d’environ 0,000049 —, ne constitue pas une véritable recommandation en regard des coûts évidents.
Une isolation extrêmement performante existe dans les accumulateurs sous vide poussé. Leur demi-vie peut atteindre neuf mois. Ils conviennent donc au stockage saisonnier de chaleur sensible. Leur construction est cependant claire : double paroi et remplissage de l’espace intermédiaire avec un granulat réfléchissant le rayonnement IFR.
De manière analogue, il existe des panneaux d’isolation sous vide qui, d’après leurs fabricants, atteignent un lambda de 0,004. Si la création d’un vide suffisamment élevé dans le matériau est effectivement réalisable techniquement, une telle valeur serait réaliste. Ce n’est cependant probablement pas intéressant en termes de prix. En cas de place limitée ou si l’on souhaite une esthétique fine, cela peut être pertinent.
Une caméra thermique ne peut justifier utilement une réduction de la charge thermique d’un bâtiment que si le type d’isolation réduit linéairement les trois facteurs de perte à leurs parts respectives dans la perte totale.
Avec XPS/EPS/laine à clapet/laine de verre/chanvre/paille/copeaux de bois, c’est plus ou moins le cas. Si l’on mesure après isolation la nouvelle valeur d’émission infrarouge, sa réduction correspond à la réduction globale attendue de la charge thermique.
L’aérospatiale (d’où provient la nanopeinture) est confrontée depuis l’invention du satellite à la tâche de maîtriser les contraintes thermiques très différenciées des engins spatiaux. Avec une nanopeinture, c’est-à-dire une peinture pure, il est facile de rééquilibrer les conditions thermiques des faces exposées ou non au soleil, par exemple de l’ISS. Le point crucial est cependant que dans l’espace il n’y a ni convection ni conduction thermique, car il y a le vide. On peut ainsi, pour ainsi dire, faire en sorte qu’à l’intérieur de l’ISS personne ne se brûle la main sur la face exposée au soleil, ni que quelqu’un qui appuie son postérieur contre la face non exposée au soleil ne gèle celle-ci. Mais pourquoi les matériaux céramiques résistants aux hautes températures protègent-ils la capsule spatiale lors de la rentrée atmosphérique ? Réponse : pas parce que la NASA ou Elon Musk seraient idiots, mais parce que la nanopeinture ne repousse que la chaleur par rayonnement, et non la convection ou la conduction thermique.
Les nanopeintures réduisent donc la part du rayonnement dans les pertes de chaleur par transmission. Et plutôt bien. Il n’existe pas de valeur précise de la part infrarouge dans la maçonnerie/le bois/le plastique/les tôles sur internet. La part de convection dépend probablement fortement de l’effet du vent. La part de conduction thermique dépend de l’humidité de l’air extérieur. Selon les conditions climatiques, la part varie donc. Et justement quand la charge thermique augmente pour des raisons météorologiques (effet du vent/pluie forte), la part infrarouge diminue. Il s’agit de rayonnement IFR long, tandis que les gains par rayonnement solaire sont constitués de rayonnement IFR court.
La réduction du rayonnement IFR long par une nanopeinture devrait représenter une faible part à un chiffre en pourcentage des pertes de chaleur par transmission et, même avec un « rendement » quasi de 100 % — exprimé par une pseudo-valeur lambda d’environ 0,000049 —, ne constitue pas une véritable recommandation en regard des coûts évidents.
Une isolation extrêmement performante existe dans les accumulateurs sous vide poussé. Leur demi-vie peut atteindre neuf mois. Ils conviennent donc au stockage saisonnier de chaleur sensible. Leur construction est cependant claire : double paroi et remplissage de l’espace intermédiaire avec un granulat réfléchissant le rayonnement IFR.
De manière analogue, il existe des panneaux d’isolation sous vide qui, d’après leurs fabricants, atteignent un lambda de 0,004. Si la création d’un vide suffisamment élevé dans le matériau est effectivement réalisable techniquement, une telle valeur serait réaliste. Ce n’est cependant probablement pas intéressant en termes de prix. En cas de place limitée ou si l’on souhaite une esthétique fine, cela peut être pertinent.